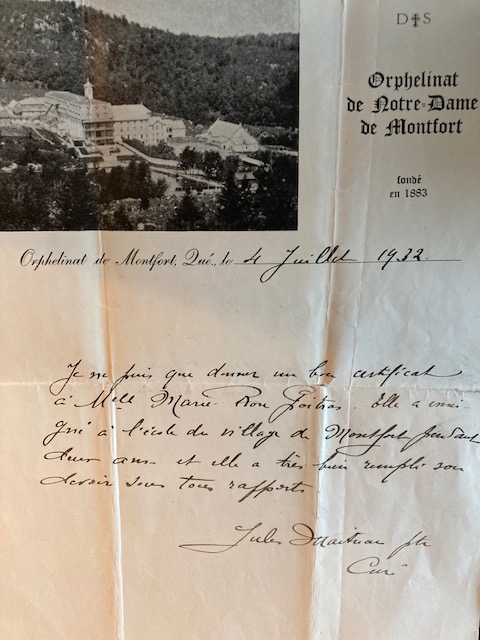Morin-Heights, septembre 1932
Note
Certains lecteurs me font remarquer que je donne surtout le point de vue de Marie-Rose dans mon récit. Il y a une explication à cela : le silence de Maxime, que l’on finira bien par nommer par son prénom (on le découvrira bientôt).
Notre* père ne parlait pas. Je l’ai déjà montré dans certaines scènes de ces histoires de famille. Il nous faudra attendre les derniers mois de sa vie pour qu’il nous raconte certains épisodes de sa vie (en particulier, la rencontre avec Marie-Rose sur la track).
Quant à notre mère, sans entrer dans les détails, elle nous raconta plusieurs épisodes de sa vie à L’Anse-à-Gilles, de ses années d’enseignement à L’Anse, à la Rivière-Ouelle et ailleurs. Puis la maladie qui l’éloigna de l’enseignement une année durant. Et l’annonce dans l’Action catholique : la commission scolaire de Montfort demandait une maîtresse d’école…
* Le « nous » n’en est pas un de majesté ou de papauté, mais de complicité avec mon frère qui m’accompagne, de là où il est, dans l’écriture de notre histoire de famille. Après tout, c’est lui qui annonça à mes parents qu’en guise de cadeau du jour de l’An 2004 — le dernier de notre mère —, j’écrirais leur histoire. Je l’entends parfois me souffler des détails qui m’avaient échappé.
&
C’est la rentrée. Marie-Rose a consulté les manuels scolaires du département de l’Instruction publique. Comme à Montfort, elle a des élèves du cours préparatoire jusqu’à la sixième année. Elle a soigneusement préparé sa classe : catéchisme, français, calcul, géographie, histoire, etc. Elle veut être fière de ses élèves quand monsieur l’inspecteur fera sa première visite.
Elle a plus d’élèves qu’à Montfort. Elle les accueille à tour de rôle et leur demande leur nom. Une petite dernière arrive en courant suivie par son grand frère, qui ne semble pas des plus heureux d’être là.
— Bonjour, mademoiselle Poitras, dit la petite fille en insistant sur le «mademoiselle Poitras».
— Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Fernand.
Le garçon la salue poliment et se dirige vers le fond de la classe.
Les élèves murmurent. Ils se connaissent presque tous. Fernand croit bon de dire au grand Forget :
— J’connais la maîtresse. Elle va se marier avec mon frère Maxime.
— C’t’a crère !
Quand tout le monde est assis en silence, Marie-Rose prend la parole :
— Je vais apprendre vos prénoms le plus vite possible. Moi, je m’appelle Marie-Rose Poitras.
Une petite voix aiguë se fait entendre :
— Moi, j’m’appelle Anne-Marie Guénette. Et vous le savez déjà, mademoiselle Poitras.
Marie-Rose regarde Anne-Marie et tente de lui faire comprendre de ne pas insister.
C’est à ce moment que le grand Forget lève la main. Marie-Rose lui fait signe de parler.
— C’tu vrai que vous allez marier Maxime Guénette ?
Marie-Rose rougit jusqu’à la racine des cheveux. Elle trouve la question assez directe. Elle retrouve ses esprits et dit :
— Je suis mieux ne pas répondre à ta question.
Fernand dit tout bas à Forget :
— Tu l’vois ben qu’c’est vrai. Est venue rouge comme une crête de coq.
— Silence, s’il vous plaît. Levez-vous. Nous allons faire la prière.
— Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit…
L’année scolaire 1932-1933 commence. Marie-Rose ne connaît pas l’avenir, mais, chose rare chez une Poitras, elle a le pressentiment, heureux, que l’année sera bonne. Elle a bien fait de s’en venir à Morin-Heights. Elle en est convaincue.
*
Elle ne sait pas encore qu’elle sera contestée dans les semaines qui suivront. Celle que désormais on ne désignera que par son initiale, « M », pour éviter toute critique malencontreuse, mais que l’on connaît déjà bien pour ses propos à l’égard de Marie-Rose, lui reprochera de ne pas surveiller adéquatement les enfants dans la cour de récréation. Le fait que Marie-Rose, de la fenêtre de la cuisine chez madame Smith, a le nez collé sur la cour de récréation ne la satisfera pas. Finalement, monsieur Bélanger de la commission scolaire demandera à Marie-Rose d’être présente dehors non seulement à l’arrivée et au départ des élèves, mais aussi à leur retour après le dîner, même si l’on gèle debout. Victoire de M sur sa rivale. À une autre époque, M aurait sans doute scandé : «Ce n’est qu’un début, continuons le combat !»
*
Quelques années plus tard, Fernand raconta, à sa façon, sa première journée d’école avec celle qui était maintenant devenue sa belle-sœur. Marie-Rose, confuse, sentant les yeux de sa belle-famille fixés sur elle, murmura :
— C’est drôle, je m’souviens pas…
— Ben voyons donc, Marie-Rose, vous étiez rouge comme une crête de coq, ajouta Fernand en riant.
Léondina mit fin à la torture de Marie-Rose.
— Fernand, mon garçon, tu m’avais pas dit que c’était toi qui avais annoncé la nouvelle au grand Forget. Même si Marie-Rose est ta belle-sœur, tu lui dois le respect. T’es comme mon frère, Bébé — c’était évidemment un surnom —, toujours en train de conter des histoires ou d’imaginer des mauvais coups.
Digression
Des années plus tard, les sœurs Céline et Colette Côté, de L’Isle-Verte, monteront à leur tour vers Morin-Heights pour y enseigner. L’histoire ne dit pas si M leur fit à elles aussi la vie dure.
Colette épousera le « Marcel à Hervé », appellation que Maxime lui donnera pour le différencier de l’autre Marcel Guénette, le fils d’Alderic et de M, par ailleurs parrain et marraine d’Hervé.
*
On comprendra que l’auteur de ces histoires de famille n’eut jamais le « plaisir » de rencontrer M, du moins il n’en garde aucun souvenir. Sa mère Marie-Rose entretiendra cependant des relations que nous pourrions qualifier de « tendues et de distantes » avec M.
Lors du décès de Léondina, après deux jours à faire en sorte de l’éviter dans la maison de Philias, Marie-Rose arriva nez à nez avec M, le matin des funérailles. Il paraît que le face-à-face fut bref et concis.
M quittera notre monde dans les années 1980… Marc ira seul à ses funérailles. Marie-Rose téléphonera cependant à Annette et à Marcel, qu’elle aimait beaucoup, pour leur présenter ses condoléances.
*
Marie-Rose se faisait de plus en plus aux silences de Maxime. Léondina lui répétait sans cesse que son Maxime n’était pas parlant, mais que c’était un bon garçon. Marie-Rose n’en doutait pas, même si elle l’aurait aimé un peu plus jasant. Il n’y avait que les dimanches, quand ils sortaient à quatre avec Gabrielle et son ami, que Maxime s’animait un peu plus. Mais, encore là, son attitude n’avait rien d’excessif. Plus tard, même avant que les femmes auraient le droit de parler, Marie-Rose ne se gênerait pas pour prendre la parole, paliant ainsi les silences de Maxime. Ils formeraient un sorte de duo : le mari silencieux et sa femme qui parle à sa place.
Maxime travaillait fort avec son père et son frère Léo, sans oublier les plus jeunes, comme Hervé et René. Rare confidence de la part de Maxime : un soir de «veillée», il raconta à Marie-Rose qu’il avait commencé à travailler à dix ans. Il s’en faisait une fierté, et non sans raison. Il était le plus vieux des garçons; il devait donc donner l’exemple à ceux qui suivaient. Maxime montra même à sa fiancée — toujours sans bague pour le prouver — le petit rabot et le petit pied-de-roi que son père lui avait donnés pour l’occasion. Le travail bien fait, le dur labeur, celui qui fait plier l’échine et les jambes sous son poids, était une valeur que Philias avait inculquée à son fils. Et la semence était tombée dans une bonne terre.
Maxime éprouvait une grande admiration pour son père qui lui avait aussi enseigné les secrets du métier de scieur de bois et de menuisier jusque dans les moindres détails. Maxime et son frère Léo n’avaient pas leur pareil pour fabriquer des portes et des fenêtres… pas de clous, pas de rivets, pas de vis, que des chevilles de bois. Léo, particulièrement, était un véritable « orfèvre » du bois.
*
Un dimanche, lors du dîner dominical chez les Guénette, une surprise attendait Marie-Rose. Toute la famille était réunie. Gabriel étrennait une robe neuve. Léondina avait mis les petits plats dans les grands. Même Anne-Marie étrennait.
Et Maxime, juste avant le dessert, PARLA ! Oui, il se leva même.
— Rose, dit-il d’une voix mal assurée…
Heureusement que Marie-Rose ne faisait pas encore d’angine de poitrine, car elle aurait sûrement fait une crise.
Léondina encourageait Maxime du regard.
— Rose, reprit Maxime, si vous le voulez bien, on pourrait se marier le 1er juillet prochain.
Il se rassit aussitôt et retomba dans son silence.
À la surprise générale, Marie-Rose se mit à pleurer et, à travers ses larmes, on entendit un « oui » qui se voulait puissant.
Gabrielle se mit à applaudir à tout rompre. Elle se leva, encourageant les autres à faire de même. Elle se dirigea vers Marie-Rose et l’embrassa. Puis rejoignant Maxime :
— Toi aussi, mon grand frère !
Elle lui donna un bec retentissant.
Léondina annonça solennellement :
— Pour l’occasion, Simone a fait ses tartes aux pommes. Les meilleures dans l’Nord, pis ailleurs, j’en suis sûre.
Marie-Rose se remit peu à peu de ses émotions. La grande demande était faite officiellement. Elle pensa : Mon trousseau ! Ma robe ! Elle se rembrunit : Ça m’a tout l’air qu’il n’y aura toujours pas de bague de fiançailles !
*
Anecdote… qui n’a rien d’anecdotique
En 1962, deux représentants du gouvernement du Québec, dont l’un « fendant », comme le qualifiera Marie-Rose, vinrent annoncer à Marc que le tracé de la nouvelle autoroute des Laurentides passerait sur son terrain. Il devrait donc renoncer à son barrage, à son tube et à sa cour à bois, mais pour le reste, le tracé ne toucherait à rien. Tout ça pour un dédommagement de misère généreusement offert par le gouvernement Lesage « au nom du progrès », ajouta le fendant fonctionnaire.
Pour Marc, c’était la fin de ce qu’il avait construit de ses mains, avec l’aide de son frère René et de son beau-frère Lucien Rochon, en 1942. Il avait su, dès l’élection de Lesage, que ce gouvernement n’aurait rien de bon. Duplessis était son homme, au grand désespoir de Marie-Rose qui ne pouvait pas le voir en peinture ou en photo… mais qui trouvait Lesage tellement beau !
Marie-Rose voulut intervenir dans la discussion, mais elle se fit rappeler, toujours par le fendant, que c’était à son mari qu’il parlait. Elle ravala tant bien que mal ses paroles, mais il ne perdait rien pour attendre…
Seul moment « heureux », si l’on peut dire, dans cet événement de malheur, un des deux fonctionnaires demanda à Marc le nom de l’ingénieur qui avait conçu le plan d’ensemble de son commerce.
— Le quoi ? demanda Marc, avant de se réfugier dans son silence.
— L’ingénieur, lui répondit le fonctionnaire fendant.
Marie-Rose éclata de rire, malgré le tragique de la situation.
— Comment ça, un ingénieur ? Mon mari a pas d’mandé à personne. Pour qui vous l’prenez ? Un ignorant ? Son père lui a tout enseigné quand il avait une douzaine d’années.
Marc pour un instant retrouva la parole :
— Pâpâ m’a toute montré : où couler la dam en ciment sur le ruisseau Saint-Louis, la dénivellation pour le tube tout en bois emboufeté avec des carcles de fer. Personne est venu me montrer comment faire. Ma femme vous l’a dit : pâpa était le meilleur pour ces affaires-là.
Cette fois, le silence de Marc se prolongea, créant un malaise certain chez les pousseux d’crayons, comme on appellerait plus tard certains fonctionnaires à l’inutilité évidente. Marie-Rose, quant à elle, fixait les fonctionnaires.
Et ne voilà-t-il pas que le fendant, qui ne pouvait accepter la défaite, demanda à Maxime :
— Aviez-vous un permis pour construire tout ça ?
Maxime ne comprenait pas où il voulait en venir. Il regarda Marie-Rose dans l’espoir qu’elle lui vienne en aide. Et il ne fut pas déçu.
— Un permis ? Quel permis ? Le seul papier que mon mari a eu, c’est le contrat dûment signé par monsieur Jean-Baptiste Latour, qui lui a vendu le terrain. Et comme le ruisseau Saint-Louis passe sur le terrain… Monsieur Latour était bien content qu’un moulin à scie se construise pour les habitants du coin. Ça fait vingt ans de ça ! Des « permis », comme vous dites, y en avait pas.
Cette fois, ni le fendant ni l’autre n’osèrent lui rappeler qu’elle n’avait pas droit de parole.
Le moment était venu pour Marie-Rose de prendre sa revanche. Elle se leva de table, se dirigea vers la porte de la cuisine, l’ouvrit, et dit sur un ton que, cette fois, le fendant ne pouvait ignorer :
— On va réfléchir à votre proposition. Ça n’a vraiment pas été une belle avant-midi.
Joignant le geste à la parole, elle leur fit signe de sortir.
Penauds, les deux fonctionnaires plièrent bagage. Mais le fendant ne pouvait pas partir ainsi…
— Si je comprends bien, lui dit-il, vous mettez deux fonctionnaires de la province de Québec à la porte ?
— Vous avez tout compris. De toute façon, de Québec ou d’Ottawa, c’est du pareil au même,
Maxime laissa échapper un soupir. Il avait toujours craint l’autorité et il la craindrait toujours. À ses yeux, on ne pouvait dire pareilles choses à des fonctionnaires.
Marie-Rose referma la porte sur les deux loustics provinciaux.
— Bon débarras ! dit-elle en revenant vers Marc, toujours silencieux. J’vas nous faire une tasse de thé, pis, à soir, j’vas appeler Raymond. J’suis sûre qu’il peut t’aider. Tu lui as pas payé un cours commercial pis les Hautes Études pour rien.
Durant qu’elle préparait la boisson qui, l’espérait-elle, adoucirait leurs maux, elle entendit Marc murmurer, la voix éteinte :
— Ça parle au yabe !
Ce n’était pas de l’étonnement. C’était une déception qu’il ne pourrait jamais oublier.
À la fin de sa vie, il reconnaîtra devant ses fils :
— Ça m’a fait ben mal ! Pis à votre mère aussi.
*